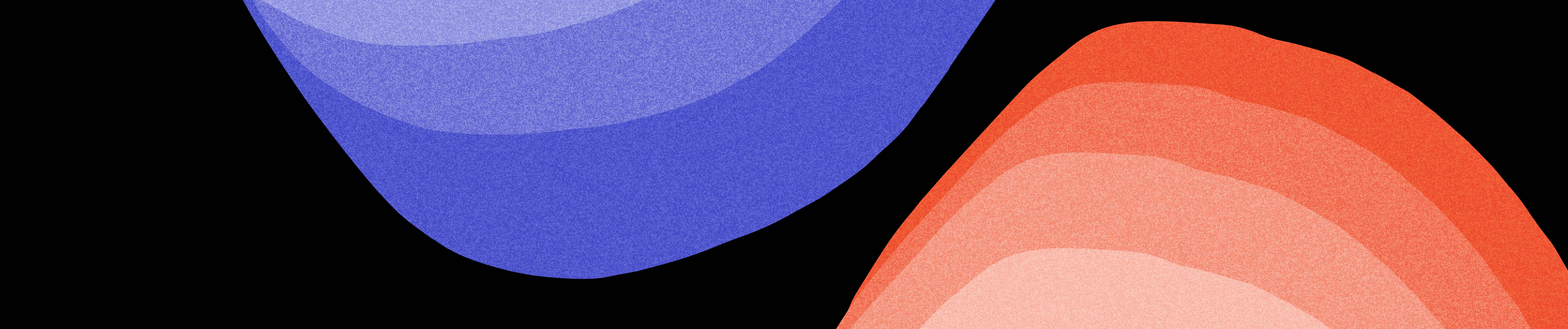Transcription
Je m’appelle Julie Laferrière et vous écoutez Dialogues, un espace de rencontre entre deux créateurs qui explorent ce qui les distingue et les unis, tant sur le plan créatif que générationnel.
Cet épisode donne la parole à l’artiste en arts visuels et en arts médiatiques Sarah Madgin et à l’artiste multidisciplinaire René Derouin. Ils se rencontrent pour une première fois. Même si près de 60 ans les séparent et que leurs approchent sont bien différentes, ils partagent cette vision de l’artiste entrepreneur.

© David Ospina
Sarah Madgin (SM) : Je me nomme Sarah Madgin, je suis terminante à l’Université du Québec à Montréal, puis je m’inscris en tant qu’artiste de la relève à Montréal.
René Derouin (RD) : Moi je suis un artiste depuis que je suis au monde (rire). Ma mère, en me voyant arriver, a dit « tiens, c’est un artiste ». Elle n’aimait pas tellement ça, mais c’était comme ça. J’ai mené une carrière énorme de 60 ans, mais toujours un peu en marge. Je n’ai pas été tout à fait dans le système. Je n’ai pas eu une formation au Québec, j’ai été formé au Mexique, aux Beaux-arts. Alors j’ai un peu un regard à distance du Québec, mais en même temps j’adore le voir à distance et je le vois bien.
Sarah quand vous regardez René, vous connaissez un peu son travail, comment vous imaginez le moment où il a commencé?
SM : Par rapport aux années 60, je pense que la transformation du paysage s’est avérée dans l’Expo 67, par exemple. Puis, il y a eu l’émergence et la création de centres d’artistes autogérés. À partir de là, je pense que les ressources se sont davantage établies. Aujourd’hui, en tant qu’artiste de la relève, je crois qu’on bénéficie de ces centres-là. Puis, il y a eu le développement de plusieurs ressources comme le CALQ.
René, si vous vous imaginiez commencer votre carrière aujourd’hui?
RD : Un jeune artiste aujourd’hui a énormément de ressources. C’est un avantage, en même temps, ça peut être un inconvénient dans le sens de la liberté. Mais ce sont tous les pays occidentaux qui sont comme ça, que ce soit la France, l’Allemagne ou les États-Unis. L’art s’est intégré beaucoup au système. Dans le sens que, ce qu’on appelait les beaux-arts, dans le temps, avait quelque chose de marginal et rebelle. Moi, mon père et ma mère ne voulaient pas que je sois un artiste. Ça n’avait aucun statut. Alors quand les beaux-arts se sont intégrés à l’Université…
L’Université en soi, ça donne un statut universitaire. « Mon fils ou ma fille va à l’université », c’est bien! Mais nous, les beaux-arts, dans le temps, c’était très mal vu. Il y a quelque chose de contestataire dans les beaux-arts, dans les arts visuels, qui étaient hors du système. Si on se rappelle au début du 19e siècle, si on parle de Matisse ou Picasso, on ne les imagine pas à l’université. Ils devenaient des artistes un peu par compagnonnage. Moi, j’ai une formation de compagnon. J’ai été formé par les autres artistes. Il faut penser que, quand j’ai commencé, le Ministère de la Culture n’existait pas. Le CALQ et la SODEC n’existaient pas. Les centres d’artistes n’existaient pas.
Sarah, quand vous entendez ça, l’idée de la collectivité… Ce que je trouve super intéressant dans ce que vous dites, c’est qu’il y avait presque quelque chose d’antinomique à vos yeux de voir un art qui s’institutionnalise, alors que par définition être artiste c’était un peu être rebelle, être en marge, et surtout ne pas répondre aux normes. Quand vous entendez ça, vous, votre réalité ce n’est pas celle-là. La réalité d’un soutien a de bons côtés aussi. Quand vous entendez ça, qu’est-ce que ça vous fait?
SM : Il y a encore un côté marginal aujourd’hui. Juste de la façon dont les gens m’abordent : « Ah, vous voulez devenir artiste? Mais qu’est-ce que vous allez faire avec ça? Comment est-ce que ça va vous rapporter d’argent? » C’est encore ça qui est questionné, je crois. Et la façon dont on va y arriver. On dirait que les gens n’ont pas conscience du cheminement qu’on peut faire. Si, par exemple, je finis l’université, quel métier est-ce que je vais pouvoir faire et de quelle manière? Qu’est-ce qu’un artiste en tant que tel? Les gens n’ont pas conscience de la difficulté. Parce qu’après l’Université, oui, on investit un milieu, on est reconnu, on forme sa petite famille. Mais après, on devient son propre entrepreneur. Oui, on a beaucoup de ressources, mais c‘est tellement contingenté… Il y a tellement de demandes que d’introduire un milieu, si ce n’est pas un centre communautaire ou un centre d’artiste, par exemple, c’est difficile de percer.
RD : Un des grands changements par rapport à ta génération et la mienne, c’est le nombre d’artistes qu’il y a dans la société. Parce que moi, on peut dire que les artistes que je connaissais à Montréal, je connaissais tout le monde. Tout le monde qui était dans ce métier-là, on pouvait les connaître. Maintenant, ça s’est multiplié par 50. Autant de galeries, autant de centres d’artistes, autant d’orientations tout à fait différentes. Mais tu as tout à fait raison, c’est intégré dans le cadre universitaire. Aussitôt que tu quittes l’Université et que tu dis « moi, je suis un artiste », il n’y a pas beaucoup de place dans la société. Même dans les médias, tu vas te rendre compte qu’on n’occupe pas, les arts visuels, une très belle place. On est comme marginalisés. Ce n’est pas intéressant pour les médias. Il y a beaucoup de place pour le show-business, mais nous, on n’est pas dans le show-business, on est dans une certaine recherche. Et ça n’intéresse pas beaucoup les médias.
[musique
Un monde sépare les deux artistes. La réalité de Sarah Madgin, qui a 22 ans, est bien différente, on l’aura compris, du contexte dans lequel René Derouin a amorcé sa carrière il y a une soixantaine d’années. Parmi ces distinctions, notons le fait qu’un artiste en arts visuels aujourd’hui doit souvent alterner entre le mode création et gestion. Une valse qui est à la fois délicate et stratégique.
SM : C’est aussi d’être son propre entrepreneur, puis de structurer une vie, justement, entre la création puis les demandes de bourses. Comment intégrer la société en tant qu’artiste, avec justement ce monde-là, le médiatique. C’est pour ça que dans mon travail je fais une fusion entre les arts plus traditionnels, analogiques, versus les plus numériques ou actuels, pour témoigner de cette évolution. Comment est-ce que je peux investir ce monde artistique aujourd’hui, puis être, pas pour dire à la marge, mais déjouer un peu ce système médiatique? Ou juste comment l’user pour l’intégrer, finalement.
RD : J’aime beaucoup le mot que tu as dit, et c’est un mot que moi j’ai utilisé souvent, mais qui était très mal vu : entrepreneur. Moi, on peut dire que j’ai réussi ma vie d’artiste, mais je suis un entrepreneur. Dans le sens où j’ai toujours entrepris quelque chose qui n’existait pas. J’ai créé une maison d’édition dans les années 70. Ensuite, j’ai été aux débuts de plusieurs associations qu’on connaît maintenant. Il y en a qui ont survécu et d’autres qui ont disparu. On était une génération où il fallait inventer des structures. La première association des graveurs, je suis un des membres fondateurs. J’ai créé une fondation, j’ai créé les Jardins du précambrien.
Quand j’allais au CALQ, voilà quelques années, on me disait : « Vous êtes une génération d’entrepreneurs-fondateurs. Est-ce qu’il va y avoir un suivi à ce que vous avez fait? Ou la nouvelle génération va-t-elle se réinventer autrement? » Je te dirais qu’actuellement, ceux qui ont créé des choses et qui veulent les léguer à d’autres… Quand tu veux léguer quelque chose, ça prend quelqu’un qui le reçoit. Mais je pense que votre génération va réinventer autre chose. On ne peut pas tellement léguer ce qu’on a fait. Vous avez peut-être besoin d’autre chose. Je le vois comme ça, alors c’est pour ça que le mot entrepreneur est bien important. Il était tellement péjoratif dans le temps, si on se rapporte voilà 20-25 ans. « Derouin c’est un entrepreneur », ça voulait dire quoi? Que je voulais faire de l’argent? Bien non, je voulais vivre.
Être artiste en arts visuels au Québec et parler d’argent, est-ce que c’est quelque chose qui est particulièrement compliqué?
SM : Je ne sais pas si c’est compliqué. Si, par exemple, j’applique à une bourse pour créer, je crois que ça fait partie maintenant d’un système et d’une manière de procéder. Mais mettre une valeur sur un travail, je pense que c’est un peu plus difficile. La valeur de l’œuvre, un peu plus que des manières d’investir et de s’intégrer aux ressources qui nous sont offertes.
En arts visuels comme pour plusieurs disciplines artistiques, certains éléments sont indissociables de la création. Peu importe l’époque, l’âge, ou le mode d’expression.
RD : En création, d’après moi, il y a deux mots qui reviennent tout le temps, c’est la passion et la liberté. Et la liberté pour moi, c’est quelque chose de fondamental. Et indépendant. Pierre Vadeboncoeur, qui est un écrivain extraordinaire, a fait une critique sur mon travail et il a dit « Derouin, c’est un être souverain ». Alors je lui avais dit « Pierre Vadeboncoeur, c’est une des plus belles choses dites sur moi ». Pas souverain dans le sens politique, parce que ça peut être associé à la politique, mais souverain comme indépendant. Je suis indépendant. Et je trouve que la liberté, c’est ce qui protège la création. Quelqu’un qui serait contraint dans les institutions, il serait un propagandiste d’une certaine idée. On est apolitiques, nous les artistes, je pense. On ne fait partie de rien. On est responsable de sa création.
Sarah, est-ce que vous vous sentez souveraine?
SM : Oui et non. Oui, souveraine de pouvoir créer, d’apposer des idées, les mettre en œuvre. Mais est-ce que je suis souveraine du système? Je ne pense pas, parce que j’en fais partie.
RD : Dans le 19e siècle, il faut bien dire que les artistes dépendaient de la grande bourgeoisie, de l’aristocratie et de la royauté. Si on parle des 17e et 18e siècles, c’était la royauté. Il y avait la contrainte pour les artistes d’être intégrés dans de grandes institutions. Pour les jeunes artistes comme toi, maintenant, l’institution est là, mais elle est entièrement nécessaire à la naissance de l’art. Sans ça, je pense qu’il n’y aurait pas de culture. Dans le système capitaliste actuellement, si on n’avait pas des centres d’artistes, des musées ou des galeries qui sont là pour la culture, entretenues un peu par l’État, il ne resterait pas grand-chose de la culture.
Sarah aborde notamment dans son œuvre Dentalium l’idée des traditions autochtones, la menace de l’oubli, le devoir de mémoire et une réflexion sur l’identité culturelle canadienne.
René, vous aussi vous avez été concerné et sensible aux questions des traditions, d’origine, d’identité, à travers le territoire?
RD : Oui, mais moi je suis tellement un vieil artiste (rires). J’ai des notions d’appartenance. Même si j’ai vécu beaucoup à l’étranger, je suis très ancré dans le territoire. J’ai appris à découvrir le territoire de l’extérieur. C’était important, quand on me posait des questions à l’École des beaux-arts à Mexico, de savoir d’où je venais. Et c’est là que je me suis rendu compte de mon ignorance. Je n’étais pas capable de définir d’où j’étais! Et cette question, je l’ai posée à Gaston Miron, qui était un ami très près. Gaston, quand tu es à l’étranger et qu’on te pose la question d’où tu viens, et que tu ne sais pas quoi répondre, parce que tu n’as pas de culture et que tu ne la connais pas, c’est terrible. Tu en souffres tellement. Quand on m’a posé la question d’où tu viens? J’ai dit : je viens du Nord. Et là, en découvrant le Nord, j’ai découvert tranquillement la nordicité. Derrière la nordicité, j’ai découvert le froid.
Il y a quelque chose que j’aimerais te dire, Sarah, que je peux te dire maintenant. Après 60 ans, je me rends compte que ce n’est pas l’œuvre que j’ai faite qui s’est matérialisée. On fait une œuvre, c’est matériel… Mais l’art m’aura permis de me transformer. Et c’est plus la transformation à travers l’art qui est l’œuvre que l’œuvre elle-même. L’œuvre est là, mais ça m’intéresse plus ou moins. Mais moi, je me suis complètement transformé à travers l’art. Je me suis formé, je me suis éduqué, j’ai voyagé. Puis j’aimerais te poser une question sur le côté extérieur à ta carrière. Est-ce que tu penses aller à l’étranger?
SM : Oui. Puisque je parle de métissage dans mon travail. J’ai ce désir d’investir chaque culture qui me forge et à laquelle je n’ai pas nécessairement accès. J’aimerais aller creuser davantage ailleurs pour voir des couleurs, découvrir des cultures qui me sont étrangères. Puis d’essayer de les combiner et de créer. Et comme vous avez dit, d’essayer de passer par l’éducation parce que c’est ce qui me passionne. J’irai en Europe, probablement. En Irlande, parce que Madgin, c’est irlandais. Mes prochains travaux sont sur ça. Je fais des recherches sur des motifs de vêtements, puis j’aimerais aller intégrer des lieux, par exemple aller voir des musées du textile. Des motifs algonquins, par exemple. Et d’essayer, par des procédés, de faire ce métissage, mais qui devient maintenant physique.
René Derouin utilise divers médiums pour ses créations. Des installations qu’on retrouve sur le site des Jardins du Précambrien à Val-David, en passant par l’influence de l’art précolombien, et par l’application de l’art mural mexicain. Il s’adonne également au dessin, à la gravure et à la sculpture. L’artiste multidisciplinaire est curieux des nouvelles techniques, des formes d’expression et des principes de diffusion des œuvres de la relève.
RD : Moi, ce que je comprends de votre génération, c’est que ton œuvre, je l’ai vue, mais je ne la verrai jamais matérielle, je l’ai vue en photo. C’est qu’elle existe dans mon imaginaire à travers un média de communication. On peut la voir à la télévision, on peut la voir dans un film… C’est ce qui est différent de ma génération, parce que l’œuvre existe sur plusieurs formes. Elle existe, même, dans l’imaginaire des gens. On la connaît, mais on ne l’aura jamais vue réellement.
Spontanément, qu’est-ce que le mot relève vous inspire?
RD : Je n’aime pas beaucoup le mot. Je trouve que l’art s’inspire de l’art. Si tu deviens un artiste, c’est parce qu’il y avait des artistes. Si tu deviens un écrivain, c’est parce qu’il y avait des écrivains. Moi, je fais une blague en disant que le plus beau paysage du monde, ça ne crée pas un artiste. On sait que Gauguin est allé à Tahiti, mais ce n’est pas à cause que Tahiti était beau que ça a fait Gauguin. Gauguin était un artiste majeur qui avait la passion de faire de la peinture, un très grand artiste. Alors il y a des gens qui vont à Tahiti et qui pensent qu’ils vont s’asseoir là et qu’ils vont devenir artistes. Il n’y a pas de lieu dans le monde pour devenir un artiste. Il y a un lieu dans le monde pour rencontrer d’autres artistes. C’est pour ça que la relève, je n’aime pas beaucoup le mot parce que si on se rencontre tous les deux, d’après moi, comme artistes, il n’y a pas de différence d’âge.