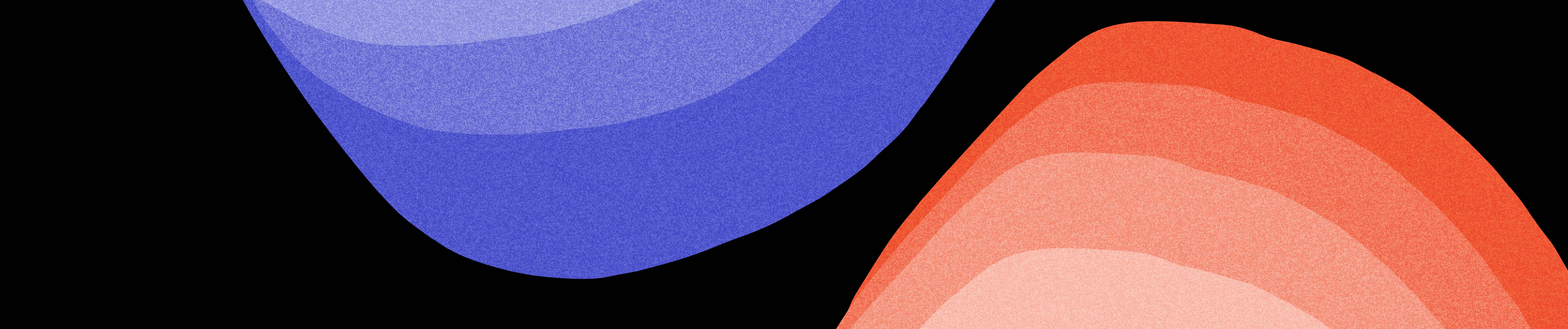L'inspiration, et puis après?
Monument de la littérature et du théâtre québécois, Michel Tremblay a mis au monde plus de cent histoires, traduites dans 40 langues à travers le monde. On lui doit, évidemment l’iconique pièce de théâtre Les Belles-sœurs, mais aussi des comédies musicales, des recueils de contes, de scénarios de films, un livret d’opéra et les paroles d’une douzaine de chansons. Immanquablement, ses textes nous évoquent la nostalgie d’un parc, la musique d’une ruelle ou la parlure colorée d’une voisine.
En 2019, le Conseil des arts et des lettres du Québec invitait l’auteur, le temps d’un entretien devant public, à la Grande Bibliothèque. Mais une rencontre avec Michel Tremblay est toujours un événement mémorable. Et donc, pour prolonger le plaisir, on vous propose de réécouter la très inspirante discussion qui a eu lieu entre l’écrivain et Brian Myles, directeur du journal Le Devoir.
Transcription
Brian Myles (BM) : Michel Tremblay, c’est un privilège d’être là aujourd’hui. On a presque tout dit de votre parcours, sauf une chose : vous êtes un chat.
Michel Tremblay (MT) : Oui, je suis un chat. J’ai décidé d’être un chat.
BM : Comment vit le chat Tremblay?
MT : Eh bien, je me suis rendu compte à un moment donné que si je me disciplinais, si je me composais une journée idéale, je pourrais sans doute continuer à travailler et c’est ce que je fais depuis, mon Dieu, depuis que je vais à Key West 91, ça fait 28 ans. Alors, je fais les mêmes choses aux mêmes heures tous les jours, exactement comme les chats. J’ai des cycles, si vous voulez connaître ma vie…
BM : Est-ce que vous demandez souvent la porte? Mon chat fait ça, moi.
MT : Non, mais je fais tout ce qu’un chat fait. Et je me suis rendu compte que faire les mêmes choses aux mêmes heures, ça m’aide à vivre probablement, c’est-à-dire que ça m’aide à m’empêcher de m’éparpiller.
BM : Avoir une discipline. L’écrivain américain Philip Roth, qui est décédé, qui a été un des rares auteurs de son vivant à faire son entrée à la Library of Congress, pour lui, c’était une torture d’écrire. Il ne pouvait pas être bien quand il écrivait, il était mal quand il n’écrivait pas. Ça a l’air facile pour vous.
MT : Il y a beaucoup de gens qui, Marie-Claire Blais par exemple, qui habite à Key West aussi, chaque fois qu’on se rencontre, qu’on va manger avec elle, elle nous dit que c’est très difficile pour elle, c’est très souffrant. Le mot qu’elle utilise, c’est « souffrant ». Il y a des gens pour qui écrire, c’est se faire souffrir. C’est vrai que des fois, on souffre parce qu’on fait vivre à nos personnages des choses qui sont, qui sont parfois bon, épouvantables, mais moi c’est un plaisir. J’avais commencé à vous l’expliquer tout à l’heure dans dans la loge, après 63 ans d’écriture, le grand plaisir qui me reste, c’est de ne pas savoir comment ça va sortir chaque matin. J’appelle ça la danse autour de l’ordinateur. Y’a des matins où t’es pas tout à fait sûr d’être prêt, alors tu vas mettre ton assiette et ta tasse dans l’évier, puis là tu rentres dans ton bureau, mais tu t’assois pas tout de suite là parce que t’as le trac. J’appelle ça la danse autour de l’ordinateur, là, t’es pas trop sûr, mais quand je m’assois et que j’allume, je mets mon écran sous tension, le plaisir que j’ai là… J’ai les mains sur le clavier et le plaisir, c’est de ne pas savoir comment ça va sortir.
BM : Où est-ce que ça s’en va…
MT : Je sais où ça s’en va exactement. Je suis rendu à telle place. Le personnage a telle chose à dire, j’ai tel décor à dépeindre, j’ai tel… en tout cas bon, n’importe quoi, mais le plaisir c’est que je ne sais pas quels mots je vais choisir, dans quel ordre je vais les mettre, comment, de quelle façon je vais construire mes phrases, comment je vais faire mon premier paragraphe. Les premiers mots qui sortent, c’est tellement, c’est vraiment jouissif. Au bout de 60 ans, ça reste encore le fun d’écrire tes premiers mots puis tout à coup, tu dis, c’est pas les bons, tu les effaces puis tu recommences. Mais le travail physique d’écrire, c’est vraiment très le fun.
BM : Et dans votre journée, la partie écriture est très condensée. Vous êtes hyper productif, vous me dites que ça ne commence pas à 4 h du matin pour se terminer à midi?
MT : C’est-à-dire que je passe des nuits blanches des fois quand mon grand problème, souvent, c’est un mot.
BM : Des nuits blanches pour un mot?
MT : À un moment donné, y’a un mot qui accroche. Ce n’est pas le bon mot, tu le sais. Il est à la page 68, il est en haut, là là à droite là, puis là t’es rendu page 106 puis tu te dis je vais tourner la page, puis je vais trouver le maudit mot, pis c’est pas lui, c’est pas le bon. Ça, tu peux passer des nuits là-dessus.
BM : Une nuit blanche pour un mot?
MT : Ah oui! Ah à peine une nuit blanche, oui, quelques heures oui oui, absolument. Tu vas dans ton dictionnaire des synonymes, tu vas dans Thesaurus dans ton WordPerfect, tu vois, tu ne trouves pas exactement le mot que tu cherches. Et très souvent, je ne sais pas pourquoi je passe des nuits blanches parce que très souvent, je le trouve à bicyclette. Ça m’est arrivé très très très souvent de, en m’en allant ou en revenant de lire au centre-ville de Key West. Je me disais, ah le v’là, c’est lui, c’est ça, c’est ça, c’est le bon mot, c’est lui. Là j’arrête, je me dis bon, j’ai pas de crayon, alors que j’ai passé une nuit dessus sans le trouver. Des fois, on se dit ça, puis c’est vrai dans la vie, quand on cherche un nom ou quelque chose, il suffit d’arrêter d’y penser pour le trouver.
BM : Vous n’avez pas de difficulté à la trouver?
MT : Quoi donc?
BM : L’inspiration? Ce n’est pas un enjeu d’être inspiré?
MT : Non, moi l’inspiration, je ne sais pas ce que c’est.
BM : Non?
MT : Vraiment… L’inspiration, c’est le sujet en fait. T’as un sujet qui t’énerve, t’as quelque chose que t’haïs là, il y a quelque chose qui… Tu veux parler de quelque chose qui… Ça pourrait être la guerre, ça pourrait être bon, n’importe quoi qui est un peu sérieux là et sûrement que c’est parti de ça. C’est parti d’une chose qui dérange un auteur. On écrit parce que, on écrit parce qu’on est prétentieux, parce qu’on a…
BM : On a quelque chose à dire.
MT : On a la prétention d’avoir des choses à dire là. La première personne que tu dois séduire, c’est toi-même. T’écris pas pour les autres, ça, c’est pas vrai. Si tu écris pour les autres, tu vas faire ton cute. Ça, mes amis sont habitués de m’entendre dire ça là, mais le plus grand danger qui guette un écrivain, c’est de faire son cute, c’est de vouloir plaire. T’es pas là pour plaire, t’es pas là pour plaire à ton public, t’es là parce que t’as la prétention d’avoir quelque chose à dire et tu le dis le plus sérieusement possible, même si c’est très comique là. Et la personne pour qui tu écris, c’est toi. Que les autres aiment ça, ça vient après. Sinon tu vas te censurer aussi, tu vas t’empêcher de dire des choses.
Je dis toujours que tant que ma mère a vécu, je n’ai pas écrit Les Belles-sœurs. Ma mère est décédée en 63, j’ai écrit Les Belles-sœurs en 65, mais j’ai, j’aurais eu trop peur justement. J’aurais eu peur de son jugement, je me serais censuré si j’avais écrit Les Belles-sœurs pendant que ma mère vivait, puis ça serait une pièce complètement différente et probablement moins forte, parce que diluée par la peur du jugement de quelqu’un. Faut pas que tu penses au jugement de quelqu’un.
BM : Vous dites que ça prend une émotion de départ. Faut avoir quelque chose à dire. Faut être fâché, enragé. Faut être pas content d’une situation.
MT : Ben, surtout pour le théâtre.
BM : Qu’est-ce qui vous fait enrager maintenant, aujourd’hui?
MT : J’écris moins, hein…
BM : Un chat contemplatif!
MT : Non là, oui, il y a encore des choses qui me choquent, mais en vieillissant… Quand on est jeune, on juge les autres. Quand on est jeune, on écrit des choses sur la société en général. On condamne la société. Si la vie est si difficile, c’est la faute du gouvernement, c’est la faute des guerres, c’est la faute de telle, telle, telle personne. Et en vieillissant, on commence à se juger soi-même. On commence à se poser des questions, à soi, plutôt que de condamner. Et j’ai arrêté d’écrire du théâtre il y a presque 10 ans, il y a 7-8 ans, parce que je me suis rendu compte que mes deux plus récentes pièces étaient des pièces de constatation plutôt que des pièces de condamnation. Alors que le théâtre est là pour agresser. Le théâtre existe pour agresser. Le théâtre existe pour crier des bêtises au monde, pour dire ça, ça va mal là, regardez comme c’est laid ou comme c’est dommage ou comme c’est triste ou comme c’est dramatique. Regardez, c’est ça, la réalité là, puis moi ça me choque.
BM : Pour vous, la nuance est très claire : le théâtre, c’est pour crier, la littérature, c’est pour murmurer une bonne histoire dans l’oreille d’une amie.
MT : Oui, oui.
BM : Et vous êtes plus dans la phase murmure aujourd’hui.
MT : D’ailleurs, une des choses qui m’ont le plus fait plaisir dans la vie, c’est que, souvent, mes amis, bon ça, c’est normal, mais souvent des gens qui me parlent de ce que j’écris, me disent, quand ils lisent mes romans, ils ont l’impression que c’est moi qui leur raconte l’histoire. Et ça, je trouve que c’est un compliment parce que c’est ce que j’essaie de faire, pas au premier premier degré là, mais j’aimerais, quand on lit mes romans, qu’on entende une voix, pas nécessairement la mienne, mais j’aimerais qu’on entende une voix. La voix, même dans mes descriptions les plus complexes, psychologiques ou les plus compliquées ou les plus, bon... Qu’on ait l’impression que c’est quelqu’un qui te raconte une histoire.
BM : Vous avez déjà dit que vous aviez la chance et aussi un certain courage d’avoir pu émerger au cœur de la Révolution tranquille. Cette époque-là était-elle si noble et grandiose qu’on la décrit aujourd’hui?
MT : Oui, mais ça, si on s’embarque là-dedans, je vais me répéter parce que je l’ai beaucoup dit. Mais ce qui est arrivé au Québec en même temps que la révolution en France, Mai 68, ce qui est arrivé d’extraordinaire au Québec, c’est que c’est une révolution douce. C’est une Révolution tranquille qui a été faite par des gens qui ne se connaissaient pas au lieu d’être comme en France, des étudiants qui se mettent ensemble pour garrocher des roches, garrocher des pavés dans les vitrines et vouloir l’évolution et la révolution, et exiger que la société change. Nous, ici, ça a été fait par des gangs qui se connaissaient pas. Le besoin était tel, après 250 ans de religion catholique, le besoin était tel de s’exprimer, que des gens… La gang de Réjean Ducharme, la gang de Robert Charlebois avec L’Osstidcho et notre gang à nous, on a produit nos premiers spectacles à l’intérieur d’une période de trois mois dans l’été 68. Et on se connaissait pas. J’avais, non, j’avais jamais rencontré… Y’a aucun de, ni Réjean Ducharme ni la gang de Charlebois. Alors, ça a été une espèce de prise de pouvoir d’une génération à travers les arts plutôt qu’à travers la rhétorique, à travers le fait de s’asseoir dans des salles, puis de parler de la révolution. Nous autres, chacun de notre bord, on a fait notre petit devoir sans penser à la révolution jamais, sans penser…
Je sais pas si vous m’avez déjà entendu dire ça, mais Les Belles-sœurs est un exercice de style. C’est pas une pièce qui a été écrite pour être jouée. Ça a été écrit par un petit gars qui avait 23 ans et qui, même s’il était pas professionnel, il savait très bien qu’écrire une pièce avec 15 personnages, ça serait plus difficile à produire qu’une pièce à deux. Alors déjà au départ, le fait que ce gars-là ait mis 15 personnages, c’est qu’il y avait une espèce d’inconscience, pas dans le sens qu’il savait pas ce qu’il faisait là, mais que c’était pas une pièce qui a été écrite pour être jouée. C’est une pièce qui a été écrite par quelqu’un qui avait besoin de dire ces choses-là et je pense que c’est la même chose avec Réjean Ducharme et son premier roman, puis avec L’Osstidcho qui a été faite par une gang qui voulait avoir du fun ensemble, puis qui ont écrit des choses qui étaient nouvelles, mais sans jamais, ni les uns ni les autres, on n’a jamais pensé à faire une révolution.
BM : C’était pas un complot?
MT : Non, c’était pas… non seulement ça, mais on n’a jamais pensé, même chacun de notre côté, à faire quelque révolution que ce soit. Ce qui m’a amené à dire après que, quand on veut trop faire la révolution, on la fait pas. Faut que ça vienne d’un besoin, faut que ça soit inconscient. Tu sais, Stravinsky quand il a composé, je sais pas moi, Le sacre du printemps, il a pas fait ça pour révolutionner la musique. Il a fait ça parce que lui, dans son développement, il était rendu à composer ça. Alors, il s’est pas dit, on en parlait tout à l’heure, qu’est-ce que la voisine va dire parce que j’ai écrit Le sacre du printemps. Picasso avec un des tableaux les plus forts au monde, avec le cheval et puis le, Guernica… Il a pas fait ça pour faire une révolution, il a fait ça parce que la guerre d’Espagne le scandalisait tellement qu’il a décidé de mettre un cheval qui souffre sur un tableau. Mais il a pas pensé à faire. Ce monde-là, ils se levaient pas le matin en disant, je vais maintenant révolutionner la peinture ou la musique. S’ils y avaient pensé, ils l’auraient pas fait. Il faut faire avant de penser. Oh, ça, c’est dangereux. Ça, c’est dangereux, mais en tout cas, dans ce cas-là, c’est vrai.
BM : Et vous situez votre émergence, à l’époque du moment, que vous avez décrit comme un moment de tension, tension entre une culture populaire et une culture bourgeoise.
MT : Honnêtement, j’ai jamais pensé à ça.
BM : Non?
MT : Moi, j’ai été élevé devant une culture bourgeoise, mais c’était pas… Le mot « culture » faisait pas partie de ça. Au théâtre, par exemple, je m’étais rendu compte que les personnages féminins, au théâtre nord-américain en général et québécois en particulier, étaient presque toujours des personnages secondaires et comiques. C’est pas venu d’un côté de… Faisons la révolution et tout ça et ne parlons plus des bourgeois, parlons des ouvriers. C’est juste que ces femmes-là n’avaient jamais eu droit de parole et sans penser au reste, sans penser à l’effet que ça pourrait avoir, sans penser à la vulgarité, sans penser à me censurer, j’avais ce besoin-là, ce mois-là et j’ai comme accompli quelque chose que j’avais besoin de faire, tout simplement en parfaite inconscience de vouloir révolutionner quoi que ce soit là. J’avais besoin de le faire, je l’ai fait, un point c’est tout.
BM : Vous étiez un féministe avant l’heure.
MT : Non, je pense que le féminisme, c’est l’œuvre des femmes et ça appartient aux femmes.
BM : Mais il y a beaucoup d’hommes aujourd’hui qui se disent féministes.
MT : Peut-être un membre honoraire du féminisme…
BM : Je pense qu’elles vous prendraient.
MT : Non, mais, encore là, si tu veux encore là là… Je pense que je peux aller jusque là. Si tu veux écrire une pièce féministe, il y a beaucoup de chances que tu te trompes, puis que tu la rates. Si d’avance tu te dis, comme pour la révolution, je vais m’asseoir maintenant et je vais écrire une pièce féministe. Les fées ont soif, ça a été écrit par une féministe qui avait besoin de dire ces affaires-là. Elle s’est pas dit je vais maintenant écrire une pièce féministe. Ça se fait pas, ça. C’est anti-écriture ou anti-invention ou anti-culture de dire d’avance, je vais maintenant écrire une pièce féministe. Tu le fais parce que t’es une femme, parce que t’as besoin de dire ces choses-là parce que la société est injuste.
BM : Mais les femmes ont une grande influence dans votre œuvre, dans votre vie. Votre mère est omniprésente à travers tout ça. Elle a eu un parcours exceptionnel.
MT : Oui oui, mais je l’ai fait naïvement. Je l’ai fait parce que je l’avais jamais vu avant. Je l’ai fait parce que j’avais besoin d’entendre cette langue-là, de voir ces femmes-là avoir du fun, pleurer, parler de leurs malheurs, se dire des bêtises, dire des niaiseries. Dieu sait qu’il y en a des niaiseries dans cette pièce-là. J’avais envie d’avoir une gang de monde que j’avais jamais vu. J’avais juste du fun à aller chercher… Le manuscrit des Belles-sœurs est ici d’ailleurs, et si vous le consultez dans la première page, il y a les noms des personnages et à côté, il y a les clichés que ces femmes-là vont représenter : la jalouse, la snob, la guidoune, entre parenthèses. Je suis allé chercher des clichés, puis j’ai mis ces clichés de femmes là ensemble sur une feuille de papier. Puis là, je suis parti, au contraire de ce que je fais maintenant là, sans savoir où je m’en allais, sans préparation. J’ai commencé une scène entre deux personnages et j’avais comme exemple… Ça, c’est un petit peu snob ce que je veux dire là. J’avais comme exemple la fin du deuxième acte des Noces de Figaro de Mozart.
BM : Pourquoi pas?
MT : Ça aussi, ça se place bien dans la conversation.
BM : Vous aviez pas dit que c’était prétentieux d’écrire aussi par moment…
MT : C’est une scène qui m’a toujours fascinée, parce que c’est une scène qui commence avec trois personnages, puis tout à coup, il y a un quatrième personnage qui arrive, et ça s’était jamais vu à l’opéra avant, un troisième personnage qui arrive. D’un coup, le jardinier arrive. Tout à coup, Figaro arrive. Tout à coup, la police arrive et là, ça devient en 20 minutes, on passe d’un personnage, bon ça dépend des productions, à 40 sur scène. Et j’ai toujours eu une admiration et un amour incroyable pour cette scène-là, qui est une scène que j’écoute très souvent. C’est tellement intelligemment structuré, en plus de la musique géniale. Et c’est un peu ce que j’ai fait avec Les Belles-sœurs, en toute simplicité.
BM : Et tous ces personnages-là ont vécu longtemps dans vos œuvres. Vous avez fait boucler des cycles importants, des cycles qui ont été des pôles majeurs, avec La Diaspora des Desrosiers, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal. Comment sont catalogués tous ces personnages-là? Y’a une bible ou c’est dans votre tête?
MT : C’est parti de choses très précises. Je me suis rendu compte très tôt… Tu sais, tu lis, je sais pas, Jules Verne quand t’es jeune ou tu lis un auteur que t’aimes là, puis tu te rends compte que les auteurs que t’aimes souvent, privilégient le même genre de personnages que d’un livre à l’autre, c’est aussi bon, c’est aussi merveilleux. Et tu te dis, regarde donc, ce personnage-là ressemble à l’autre dans l’autre livre. Alors, très tôt après À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, qui a été écrite en 70, j’ai eu envie d’écrire une deuxième pièce sur une des deux filles et une troisième pièce sur la deuxième des deux filles. Je me suis dit, plutôt que d’écrire une pièce avec un personnage qui va ressembler à Manon, eh bien je vais écrire une pièce sur Manon un moment donné, et la même chose avec Carmen. Et c’est parti de là, l’idée de… Parce que ça, c’est longtemps ça, 70. C’est 8 ans avant La grosse femme d’à côté est enceinte. Et à force de réutiliser les mêmes personnages, je me suis dit, si je reprends les mêmes personnages… J’ai jamais eu peur de me répéter.
BM : Non? C’est une question qu’on se pose.
MT : Je me suis toujours dit, je vais essayer de creuser de plus en plus, de façon à ce qu’on les connaisse et qu’on les aime de plus en plus. Et un moment donné, quand j’ai eu fini le cycle des Belles-sœurs, qui étaient 11 pièces, écoute, entre 65 et 76, pendant un an et demi, j’avais plus rien à dire, j’avais fini. Mon cycle des Belles-sœurs était terminé. J’avais plus rien à dire, alors je me suis tu. J’avais toujours dit, quand j’aurai plus rien à dire, je vais me fermer la gueule. Alors, c’est là que j’ai eu l’idée de reprendre mes personnages, de les rajeunir et c’est comme si j’avais écrit la fin de la Bible et puis que j’avais fini par le début. J’ai écrit l’apocalypse, je les ai rajeunis de 25 ans, j’ai écrit le milieu, puis récemment, avec La Diaspora des Desrosiers, j’ai écrit la genèse, ce qui fait que j’ai fait mon œuvre à l’envers.
BM : Et ça fait des personnages très riches aussi?
MT : Oui!
BM : On a dit de votre œuvre qu’elle était universelle et vous avez été parmi les premiers à sortir du Québec, rayonner, être traduit…
MT : Ça là, on va-tu régler ça une fois pour toutes?
BM : Ben oui. Bon, maintenant qu’on est entre nous, réglons ça.
MT : J’ai une formule depuis quelques années. Tous les auteurs qui sont un tant soit peu bons sont universels. On n’est pas plus universel parce qu’on est né en France que parce qu’on est né au Québec ou parce qu’on est né en Haïti. Ça, c’est pas vrai. Il y a des cultures qui sont puissantes, qui peuvent imposer leur culture aux autres; les Américains, les Français, les Italiens, bon, l’Europe, qui existe depuis plus de 1000 ans, 2000 ans des fois. Mais l’universalité d’un texte se situe dans la qualité de l’écriture, dans la pertinence de l’écriture. Chekhov n’était pas universel parce qu’il était russe, il était universel parce qu’il a écrit des pièces et des nouvelles, et en réussissant à décrire l’âme russe de façon tellement géniale que tout le monde dans le monde peut s’identifier aux personnages russes. C’est ça, être universel. Ça, c’est comme l’homosexualité. À un moment donné, à Toronto, à Vancouver, on me critiquait il y a une quarantaine d’années, y’a longtemps là, on me critiquait parce que j’étais pas assez politique.
BM : Donc, vous n’étiez pas revendicateur…
MT : Et ma façon d’être politique en parlant de l’homosexualité à moi, c’était de ne pas l’être justement. Et quand Le Cœur découvert est sorti en France par exemple, j’ai reçu des centaines et des centaines de lettres de gens qui me disaient : c’est la première fois que je lis un roman, des straights là, qui disaient que je lis un roman dans lequel je peux m’identifier à un personnage homosexuel. Alors c’était ma façon à moi d’être politique, c’était que n’importe qui au monde qui peut lire Le Cœur découvert peut être touché par le personnage de Jean-Marc qui rencontre un gars, qui a un enfant, qui a 40 ans, qui s’attendait pas à avoir une enfant dans sa vie et qui est obligé d’accepter la présence d’un enfant dans sa vie.
BM : Êtes-vous exigeant comme lecteur? Êtes-vous exigeant avec nos artistes?
MT : Oui, je suis exigeant dans le style. Oui oui, je suis exigeant, je pense. Mais j’ai appris à crisser les livres sur le mur quand je les aime pas. Pendant des années, peut-être jusqu’à l’âge de 40 ans, je lisais jusqu’au bout le livre de 1500 pages le plus plate au monde. Je me rendais au bout parce qu’un livre, il faut que tu finisses ça.
BM : Vous étiez judéo-chrétien.
MT : Et un moment donné, j’ai été plus vieux et je me suis dit, là il me reste moins de temps à lire là et je me suis mis à cesser de lire. Je leur donne 100 pages. Je leur donne 100 pages, pas 10, des fois, les 10 premières sont plates, mais au bout de 100 pages, si t’aimes pas ça, arrête de le lire ou reprend le plus tard. Il y a un livre qui me tombe des mains par exemple, c’est Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Mais Théophile Gautier en général, même si j’aime beaucoup la littérature du 19e siècle, ce livre-là, je l’ai commencé quatre fois et je l’ai crissé sur le mur quatre fois. Ça m’ennuie profondément. Je suis pas capable de m’intéresser, j’aime pas les héros, j’aime pas… Il part avec la gang de gipsys puis il s’en va dans un château. J’aime beaucoup les descriptions, j’adore les descriptions, mais les descriptions de boutons de culotte, pis de rubans pis de… moi, ça m’intéresse pas.
BM : Quel regard vous portez sur notre devenir? On a l’air de quoi culturellement?
MT : La jeune génération… Les deux générations après moi ont beaucoup beaucoup parlé d’eux. C’était une génération qui parlait d’elle-même beaucoup, qui parlait pas socialement. Et les nouveaux auteurs de théâtre, les nouveaux auteurs... Je viens de lire un roman extraordinaire qui s’intitule Vernissage de Benoît Côté. Si vous avez une chance de lire ça, c’est un roman extraordinaire. Et les jeunes jeunes maintenant là, avec les nouvelles filles qui sont arrivées; elles se sont mises à parler de la société en général, puis c’est drôle parce que bon, j’ai 77 ans, c’est sûr qu’une fille qui écrit un roman à 23 ans va m’apprendre des choses. Ce que je trouve extraordinaire en lisant les jeunes auteurs, c’est que j’apprends une société que je connais pas parce que je la fréquente pas, parce que je suis trop vieux. Alors, La déesse des mouches à feu par exemple, m’a appris quelque chose sur les adolescentes que je savais pas du tout ou les romans Simon Boulerice m’apprennent des choses sur sa société à lui qui n’est pas la mienne.
Je m’appelle Nicolas Ouellet et vous venez d’écouter Dialogues, un balado produit par le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec le journal Le Devoir, BaNQ et Savoir Média. Musique et montage : Magnéto
Si vous avez aimé ce balado, poursuivez votre écoute dans les prochains épisodes avec Joséphine Bacon, Michel Marc Bouchard et Kim Thúy.